Le bilinguisme peut-il avoir un impact positif sur le développement des fonctions exécutives et donc améliorer la théorie de l’esprit des enfants atteints d’autisme ? Dans cet article, Stéphanie Durrleman tente de répondre à cette question en présentant une revue concise de la littérature scientifique ainsi qu’en évoquant une étude récente qu’elle a menée sur ce thème.
Contexte
- Le bilinguisme, c’est-à-dire l’usage de deux ou plusieurs langues (Grosjean, 1992), est aujourd’hui un phénomène prédominant. En effet, la majorité de la population du monde est actuellement bilingue, c’est-à-dire utilise régulièrement plus d'une langue dans sa vie quotidienne (Baker, 2011; Bhatia & Ritchie, 2013 ; Grosjean, 1982; Saville-Troike, 2006). En Suisse, il s’agit même de plus de deux tiers de la population, selon une enquête récente de l'Office fédéral de la statistique (Federal Statistical Office’s language, religion and culture survey, 2021). En somme, le bilinguisme devient plus la norme que l’exception.
- Le Trouble du Spectre de l’Autisme, ou TSA, est aussi un phénomène fréquent. En effet, arld.ch de la population a un diagnostic d’autisme, selon les estimations récentes (Fombonne, 2020 ; Centers for Disease Control, 2022), ce qui en fait l'un des troubles neurodéveloppementaux les plus courants de nos jours.
- Malgré ces deux constats, ce que nous savons jusqu'à présent au sujet l’intersection du bilinguisme et de l’autisme reste assez modeste car les travaux sur le développement du langage et de la cognition dans le cas du bilinguisme se sont, jusqu’à présent, plutôt concentrés sur les populations autres que l’autisme.
Impact Sociétal
Étant donné l'absence de travaux sur les personnes bilingues atteintes d’autisme, les parents et les soignants manquent souvent de recommandations claires. Ils craignent d’opter pour un environnement avec plus d’une langue, par peur que cela entrave le développement de l’enfant (Kremer-Sadlik, 2005 ; Kay-Raining Bird et al., 2012 ; Beauchamp & MacLeod, 2017 ; Hampton et al., 2017 ; Dai et al., 2018). Les extraits d’entretiens avec les parents d’enfants autistes (Hampton et al., 2017) témoignent du fait que les parents et proches aidants imaginent que se concentrer sur une seule langue serait « plus facile », enlevant de la « confusion ». Ils trouvent souvent écho de cette perspective auprès de professionnels bien intentionnés, soulignant que les « médecins » semblent s’accorder sur le fait qu’il faut plutôt se concentrer sur, voire se limiter à, la langue de la société dans laquelle l’enfant évolue, dissuadant ainsi les parents de maintenir le bilinguisme.
Pourtant, abandonner une des langues maternelles des parents donne lieu à une série d'effets en cascade, notamment la création de situations où les parents s'adressent à leurs enfants atteints d’autisme dans une langue étrangère, qu’ils parlent potentiellement moins couramment que leur langue maternelle, voire très peu. Ceci peut avoir un impact sur la qualité de l’apport langagier, mais aussi sur la quantité, car on ne parle pas aussi aisément et donc potentiellement moins dans une langue qu’on ne maîtrise pas. Les parents et proches-aidants expriment la « peur » de dire les choses incorrectement dans une langue étrangère et donc de faire apprendre des erreurs langagières à l’enfant sur le spectre autistique, donnant lieu à des frustrations liées à des freins de communication, et générant frustrations et coupures avec leurs communautés familiales ou sociales (Hampton et al., 2017).
Ces différents défis liés au dilemme par rapport au bilinguisme seraient potentiellement évités en maintenant un contexte bilingue, il convient alors de se demander si le choix de renoncer au bilinguisme est vraiment justifié.
Point sur la recherche
Dans cette revue de littérature, concentrons-nous de près sur certaines caractéristiques des enfants TSA en termes de langage et de cognition et ce que l’on sait des effets de bilinguisme sur ces caractéristiques, que ce soit dans le cas des enfants à développement typique ou avec TSA. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5ème édition (DSM-5, APA, 2022), identifie notamment une altération de la communication sociale et des comportements et des intérêts restreints ou répétitifs.
Les défis de communication sociale se situent à différents niveaux. Par exemple, on peut observer des difficultés langagières, avec à peu près un tiers des enfants TSA qui ne développe pas de langage fonctionnel (Tager-Flusberg & Kasari, 2013 ; Norrelgen et al., 2015 ; Maenner et al., 2016). On constate aussi que les interactions sociales restent souvent difficiles pour les personnes atteintes d’autisme, qu’elles soient verbales ou non-verbales, car ces personnes présentent un déficit dans le domaine appelé la Théorie de l’Esprit (TdE), qui est la capacité de comprendre les perspectives d’autrui et ainsi de prendre en compte le point de vue de ses interlocuteurs, ce qui est nécessaire à des interactions sociales fluides. Des troubles dans le domaine de la TdE affecteraient ainsi la socialisation chez les TSA et contribueraient à expliquer un de leurs défis caractéristiques (Baron-Cohen, 1995).
En ce qui concerne l’autre défi caractéristique évoqué, c’est-à-dire les comportements ou les intérêts restreints ou répétitifs, il serait en lien avec une vulnérabilité dans le domaine des Fonctions Exécutives (FE). Ces fonctions incluent la capacité à gérer son attention au mieux pour atteindre ses objectifs. Il s’agit donc de compétences fondamentales pour pouvoir désengager son attention de quelque chose de moins pertinent sur le moment afin de la réorienter sur autre chose de plus approprié dans un contexte déterminé. Ainsi, cela nous permet de ne pas rester bloqué sur les mêmes sujets ou comportements lorsque ce n’est pas opportun. De cette manière, les troubles au niveau des FE affecteraient les comportements et intérêts chez les TSA.
Il est important de souligner qu’il existe une hypothèse selon laquelle ces fonctions peuvent aider à développer une meilleure théorie de l’esprit. En effet, lorsqu’on effectue une tâche de TdE, on doit garder en mémoire différentes actions d’un protagoniste et inhiber sa propre perspective afin de considérer celle de l’autre.
Le langage et le bilinguisme
Bien que l’enfant bilingue doive diviser son attention entre ses langues, lorsqu’on prend en compte tous ses mots, il y a une similarité de richesse lexicale entre bilingues et monolingues. Le bilinguisme n’est donc pas néfaste pour le développement en vocabulaire. Du point de vue du rythme d’acquisition linguistique, on observe aussi les mêmes étapes chez des enfants monolingues et bilingues équilibrés (Genesee et al., 2004 ; Kay-Raining Bird, et al., 2016), et dans les cas où les bilingues sont moins exposés à une de leurs langues, les retards éventuels dans cette langue-ci sont rattrapés au fur et à mesure avec l’exposition (Oller, Pearson, & Cobo-Lewis, 2007; Paradis, 2016). Le développement langagier des bilingues passe donc par des étapes langagières similaires à celles de leurs pairs monolingues, et les enfants exposés à deux langages sont plus ou moins à égalité à ceux exposés à une seule sur une série de compétences langagières.
Les travaux préliminaires continuent de suggérer des étapes langagières similaires entre bilingues et monolingues. En effet, on constate des performances semblables dans différentes compétences linguistiques, que ce soit en production ou en compréhension, surtout lorsque les deux langues sont prises en considération dans les évaluations (Petersen et al., 2012 ; Dai et al., 2018 ; Gonzalez-Barrero & Nadig, 2017 ; Beauchamp et al., 2020). Dans l’ensemble, les études tendent donc à montrer que le bilinguisme n’est pas néfaste pour le développement langagier comme cela a parfois pu être suggéré, et qu’un enfant avec autisme peut tout à fait évoluer favorablement en contexte bilingue.
La Théorie de l’Esprit et le bilinguisme
La théorie de l’esprit est une construction cognitive globale qui implique la capacité à prendre en compte le point de vue des autres personnes, leurs idées et leurs croyances, et de se rendre compte que ces croyances sont des représentations mentales qui peuvent parfois ne pas coïncider avec les nôtres et avec l'état réel des choses (Premack et al. 1978 ; Perner ; 1991). Chez les enfants tout-venant, la réalisation que les idées sont subjectives et non pas objectives, et donc peuvent être fausses, est généralement consolidée vers l’âge de 4 ans (Wellman & Liu, 2004), mais elle peut demeurer un défi même à l’âge de 11 ans dans les cas d’enfants porteurs d’autisme (Baron-Cohen et al., 1985 ; Happé, 1995).
Chez les enfants à développement typique, les bilingues réussissent plus tôt les tâches de changement de localisation et de changement de contenu que les monolingues
(Chan, 2004 ; Goetz, 2003; Kovács, 2009, Diaz & Farrar, 2018, Berguno & Bowler, 2004; Bialystok & Senman, 2004). De plus, les bilingues obtiennent de meilleurs résultats que leurs pairs monolingues (Schroeder, 2018). Ce bénéfice du bilinguisme pourrait être expliqué par le fait que les bilingues se rendent compte que certaines personnes ne parlent qu'une seule de leurs langues et ne partagent donc pas nécessairement leurs connaissances, et par conséquence ne partagent pas leurs états mentaux. Autrement dit, les personnes différentes peuvent avoir des représentations différentes d'un même événement (linguistique ou mental).
Les Fonctions Exécutives et le bilinguisme
Les compétences des FE nous permettent d’orienter notre attention et de nous organiser pour atteindre au mieux nos objectifs du moment. Ces fonctions cognitives permettent ainsi de réaliser une multitude d’actions de la vie quotidienne afin d’atteindre des objectifs en contrôlant son comportement. Elles comprennent notamment 3 compétences : la mémoire de travail, l’inhibition et la flexibilité cognitive. Dans l’ensemble, toutes ces compétences sont utilisées quotidiennement et nous permettent d’avoir un comportement adapté à la situation.
Comme souligné plus haut, les FE sont souvent altérées chez les personnes avec autisme. Il leur est difficile de se désengager de la tâche ou du sujet en cours, et donc elles éprouvent de la difficulté avec les tâches faisant intervenir les fonctions exécutives. Ces difficultés avec les FE se retrouvent également chez les enfants tout-venant plus jeunes, comme le démontre leur performance lors des tâches évaluant les FE. Lorsqu’un enfant préscolaire à développement typique participe à une tâche de flexibilité mentale couplée avec l’inhibition, comme celle demandant à l’enfant de trier des objets selon leur couleur et puis de changer pour les trier selon leur forme (Zelazo, 2006), dans un premier temps l’enfant va persister dans la règle qui n’est plus adéquate, classant encore les images par couleur plutôt que selon les formes. Comme dans le cas de l’acquisition de la TdE, ces difficultés vont s’atténuer avec le temps car les compétences en FE vont se développer très naturellement chez l’enfant tout-venant. Chez les enfants porteurs d’autisme, elles peuvent rester affectées plus longtemps ce qui explique plusieurs particularités comportementales (persévérance, répétitivité…) et leur difficulté avec les tâches de FE.
Tout comme pour la TdE, les travaux mettent aussi en évidence un avantage pour les bilingues tout-venant pour les FE, c’est-à-dire qu’ils ont des meilleures compétences que leurs pairs monolingues en mémoire de travail, en inhibition et en flexibilité mentale (Morales, Calvo & Bialystok, 2013 ; Soliman, 2014; Grundy & Timmer, 2017 ; Bialystok, 2001).
Que dit la littérature sur les FE dans les contextes de bilinguisme chez les TSA ? Il n’y avait qu’une seule étude avant les nôtres qui avait examiné cette question dans des groupes de 10 enfants bilingues sur le spectre autistique comparés à 10 pairs monolingues. Ces groupes étant fort restreints, nous devons interpréter les résultats avec prudence, néanmoins les auteurs révèlent les scores plus élevés chez les bilingues atteints de TSA que chez leurs pairs monolingues lors d’une tâche comme celle évoquée ci-dessus (tris selon la couleur et ensuite selon la forme). Ceci est encourageant comme résultat préliminaire, mais les échantillons sont tellement faibles qu’on ne peut pas en tirer de conclusions fortes. D’autres travaux sont donc nécessaires, d’où la motivation pour notre étude.
Le bilinguisme peut-il améliorer la TdE et des FE chez les enfants avec TSA ?
Dans cette section, je vous présenterai les grandes lignes d’une étude que nous avons menée qui évalue ces capacités cognitives de FE et de TdE chez les enfants bilingues avec autisme. Par cette étude, nous nous demandons s’il y a un lien entre ces capacités, et plus précisément si une amélioration des FE due au bilinguisme contribuerait à améliorer la TdE.
La logique de cette étude de Peristeri et al., 2022, qui a été publiée dans le journal Autism Research, était la suivante : comme le bilinguisme améliore la TdE chez les DT, pourquoi ne le ferait-il pas chez les TSA aussi ? De même, comme les FE chez les DT peuvent être améliorées par le bilinguisme, qui exige de constamment changer d’une langue à une autre, le bilinguisme pourrait-il aussi améliorer les FE chez les TSA ? Autrement dit, il convient de se poser les questions de recherche suivantes :
- Les enfants TSA bilingues sont-ils plus performants que leurs pairs monolingues en termes de Théorie de l’Esprit et des Fonctions Exécutives ?
- Si oui, est-ce que les Fonctions Exécutives améliorées des bilingues expliquent leur meilleure performance en Théorie de l’Esprit ?
Dans notre étude, nous avons recruté et testé 103 enfants atteints d’autisme (âge moyen = 11,48 ans). Parmi ces enfants, 43 étaient bilingues et ils ont été appariés à 60 enfants monolingues). Dans les deux groupes, on avait une majorité de garçons, qui n’est pas surprenant puisque le TSA affecte plus de garçons que de filles (Fombonne, 2009). L'étude s'est déroulée en Grèce. Les enfants monolingues étaient donc tous de langue grecque, tandis que les enfants bilingues étaient majoritairement de langues Albano-grecque. Le niveau de QI, la symptomatologie de l’autisme ainsi que le niveau socio-économique ont été contrôlés.
Différentes tâches ont ensuite été utilisées pour évaluer les participants dans les domaines précités : c’est-à-dire le langage, la théorie de l’esprit et les fonctions exécutives. Les détails de ces évaluations se trouvent en annexe. Pour les tâches de langage, la langue d’évaluation a été le grec. Le vocabulaire a été examiné en production et en compréhension (Vogindroukas et al., 2009 ; Georgas et al., 1997), tout comme la syntaxe (Stavrakaki & Tsimpli, 2000; Peristeri & Tsimpli, 2010).
L’évaluation de la théorie de l’esprit a été réalisée par moyen d’une tâche de fausse croyance (Forgeot d' Arc & Ramus, 2010). La tâche a été adaptée des travaux précédents évaluant la TdE chez les populations autistes (Forgeot d’Arc & Ramus, 2011, Burnel et al. 2017). La tâche était composée de vidéos mettant en scène deux personnages, dont certaines ciblaient la TdE et d’autres ciblaient juste la capacité des participants à suivre ce qui se passait dans ces vidéos sans mettre en jeu la compréhension des croyances.
Enfin, nous avons administré deux mesures de fonctions exécutives par une tâche d’attention visuelle et flexibilité (‘Global & Local Task’, Navon, 1977) et une tâche impliquant la mise à jour, le mémoire de travail, et l’inhibition (‘2-back Task’, Kirchner, 1958). Lors de ces deux tâches de FE, nous mesurons la précision de réponse et aussi le temps de réaction.
Résumé des résultats
En ce qui concerne le langage, une limitation de notre étude est que nous n’avons pas pu évaluer nos participants bilingues dans leurs deux langues, l’albanais et le grec, car nous n’avions pas les tâches en albanais, et nous savons que cette approche peut être limitante pour vraiment refléter les capacités langagières développées dans deux langues. C’est donc sans surprise que les monolingues ont montré un avantage au niveau de la production lexicale et syntaxique. En effet, tous nos bilingues parlaient à la maison une autre langue que celle des évaluations, et ils étaient possiblement un peu plus timides pour s’exprimer dans cette langue. Notons néanmoins que ces différences de scores étaient indétectables lorsqu’il s’agissait de tâches langagières évaluant la compréhension. En effet, crucialement, même avec le biais d’être évalués dans une seule de leurs langues, aucune différence significative n’a pu être observée entre les bilingues et leurs pairs monolingues pour les tâches langagières en réception, que ce soit au niveau lexical ou au niveau syntaxique. Le bilinguisme n’empêche donc pas les participants avec TSA de comprendre aussi bien que les monolingues.
Tournons-nous à présent sur les performances aux tâches évaluant la cognition, qui étaient le focus de cette étude. Pour la première tâche de FE, le ‘global-local’, nous avons constaté que les bilingues étaient significativement plus forts que les monolingues lorsqu’il fallait se désengager des détails et voir les grandes lignes, ce qui est souvent une faiblesse associée au TSA. Cependant, nous n’avons pas observé de différence significative pour les temps de réaction entre les groupes monolingues et bilingues. En ce qui concerne la deuxième tâche de FE, la tâche ‘2-back’, les bilingues ont de nouveau fait preuve de significativement plus de précision que leurs pairs monolingues. Une fois de plus, au niveau du temps de réaction, aucune différence n’a pu émerger.
Pour ce qui est de la tâche de TdE, nous remarquons pour les items cibles évaluant les croyances, que la performance des bilingues est significativement meilleure que celle des monolingues. Les items de contrôle d’attention et de compréhension, qui n’évaluaient pas les croyances mais uniquement la capacité à comprendre l’enchaînement de cause à effet, n’a pas montré de différence significative entre les bilingues et monolingues.
Enfin, nous n’avons pas mis en évidence un lien entre les performances améliorées des bilingues en FE et leurs meilleurs scores en TdE.
Discussion
A la lumière des meilleurs résultats des bilingues en TdE et FE, il semble que le bilinguisme stimule certains aspects de la cognition chez les enfants TSA. En effet, les bilingues montrent plus de précision que leurs pairs monolingues lorsque sont évaluées les croyances d’autrui, l’inhibition et la flexibilité mentale. En revanche, ils ne sont pas plus performants en compréhension des enchaînements logiques, ni en rapidité des réponses. Donc le bilinguisme ne rend pas plus fort partout : les bénéfices qui ont été constatés se situent dans les domaines spécifiquement affectés par la condition autistique. Soulignons que ces avantages cognitifs émergent malgré un désavantage dans le domaine socio-économique chez les bilingues, qui évaluaient dans un milieu significativement moins élevé au niveau socio-économique que leurs pairs monolingues.
Nos résultats n’ont toutefois pas permis de confirmer que les deux avantages en FE et TdE soient liés. Ainsi ce n’est pas clairement parce qu’on inhibe mieux ou qu’on est plus flexible mentalement que cela nous permet forcément d’atteindre un meilleur niveau de compréhension des croyances. Il faut d'autres études pour mettre en lumière la raison sous-jacente des gains en TdE associé au bilinguisme.
Les avantages cognitifs potentiels du bilinguisme constatés chez les participants atteints de TSA dans ce travail sont très encourageants. De plus, nous avons très récemment pu observer ces mêmes gains pour d’autres tâches de FE et de TdE à différents âges (6 ans et 9 ans) grâce à une étude longitudinale (Durrleman et al., 2022). C’est pourquoi nous pouvons conclure que le bilinguisme ne semble pas nuire au développement des enfants TSA, au contraire, et il est important que ceci soit porté à la connaissance des parents et professionnels.
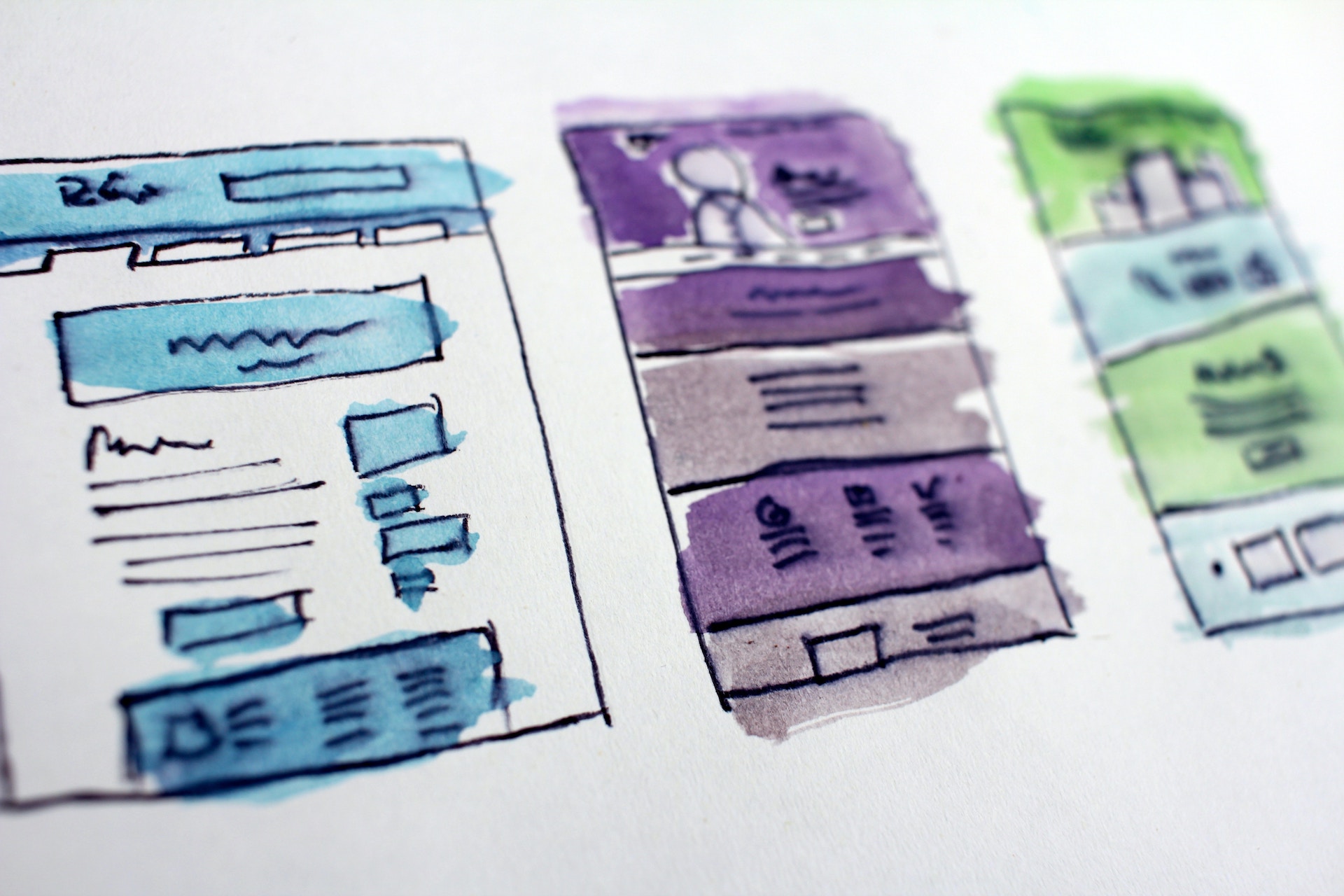

Nice
- Le bilinguisme, c’est-à-dire l’usage de deux ou plusieurs langues (Grosjean, 1992), est aujourd’hui un phénomène prédominant. En effet, la majorité de la population du monde est actuellement bilingue, c’est-à-dire utilise régulièrement plus d'une langue dans sa vie quotidienne (Baker, 2011; Bhatia & Ritchie, 2013 ; Grosjean, 1982; Saville-Troike, 2006). En Suisse, il s’agit même de plus de deux tiers de la population, selon une enquête récente de l'Office fédéral de la statistique (Federal Statistical Office’s language, religion and culture survey, 2021). En somme, le bilinguisme devient plus la norme que l’exception.
- Le Trouble du Spectre de l’Autisme, ou TSA, est aussi un phénomène fréquent. En effet, arld.ch de la population a un diagnostic d’autisme, selon les estimations récentes (Fombonne, 2020 ; Centers for Disease Control, 2022), ce qui en fait l'un des troubles neurodéveloppementaux les plus courants de nos jours.
Le Trouble du Spectre de l’Autisme, ou TSA, est aussi un phénomène fréquent.
- Malgré ces deux constats, ce que nous savons jusqu'à présent au sujet l’intersection du bilinguisme et de l’autisme reste assez modeste car les travaux sur le développement du langage et de la cognition dans le cas du bilinguisme se sont, jusqu’à présent, plutôt concentrés sur les populations autres que l’autisme.

Malgré ces deux constats, ce que nous savons jusqu'à présent au sujet l’intersection du bilinguisme et de l’autisme reste assez modeste car les travaux sur le développement du langage et de la cognition dans le cas du bilinguisme se sont, jusqu’à présent, plutôt concentrés sur les populations autres que l’autisme.
Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !Du texte !
Une citation pour mettre en avant du texte et montrer qu'on fait bien les choses.
Bibliographies
- Une référence
- 2 références



